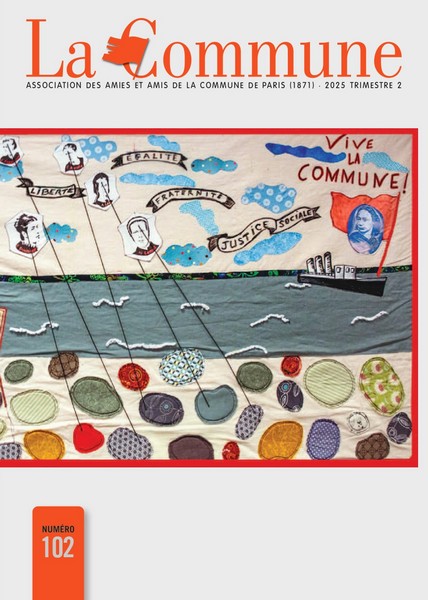D’abord, il est nécessaire d’avoir en tête la durée longue de la révolution de 1789-1793, par rapport à la brièveté de la Commune de mars à mai 1871.
Ensuite, de savoir que le souvenir de la première était encore vivant dans les esprits, comme en témoigne la représentation du grand-père révolutionnaire de Courbet, au premier plan et en costume d’époque, dans L’Enterrement à Ornans, peint en 1851. Enfin, si Paris est le centre de l’activité dans les deux cas, la capitale parle au nom de la Nation dans le premier et se propose en exemple autonome dans le second.

LA LIBERTÉ D’EXPOSER
En 1789, l’Académie royale est le siège des luttes entre conservateurs, réformateurs et radicaux, qui vont jusqu’à boycotter le Salon officiel. La Révolution a des soutiens chez les jeunes : en août, les élèves organisent des gardes pour protéger les œuvres exposées. Onze femmes artistes ou femmes d’artistes, vêtues de blanc et d’une ceinture tricolore, viennent à Versailles à l’Assemblée nationale offrir leurs bijoux pour réduire la dette publique. En mars 1790, David se positionne publiquement pour la suppression de l’Académie, où les réunions contradictoires se suivent, et fonde avec Restout [1] la Commune des Arts, qui rassemble environ 300 artistes libres. Le Salon est organisé en 1791, premier Salon libre de l’histoire, où exposent 250 artistes, contre 88 au salon précédent et 360 au suivant en 1793.
Cette même année, l’Académie est supprimée en septembre, les ex-académiciens sont invités par la Commune des Arts à livrer leurs titres et brevets aux flammes après que le mari d’Élisabeth Vigée-Lebrun eut rendu ceux de sa femme, alors en exil.
Le 10 août 1793 un grand autodafé est organisé par David pour la Fête de l’Unité. On y brûle des tableaux et des livres au pied d’une statue de la Liberté en plâtre et devant des spectateurs installés dans des gradins. L’Institut de France est créé deux ans plus tard en remplacement des quatre académies.
Par contre, la Fédération des artistes de 1871 ne perd pas son temps à s’occuper d’une académie déconsidérée dans le milieu artistique et à brûler quoi que ce soit. Elle proclame le 13 avril « la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges », mais, si elle réunit 400 artistes au grand amphithéâtre de l’École de médecine, elle n’a pas le temps d’organiser le fameux Salon pendant l’été.

L’ÉGALITÉ DES DROITS
En 1790, les débats sur le sujet de l’égalité font rage. En septembre, les rares femmes de l’Académie prennent la parole et obtiennent la suppression du quota de quatre [2], le droit de vote et d’enseignement. Deux jours plus tard, ces décisions sont reniées, au motif que les opinions exprimées avaient été soutenues avec une chaleur immodérée et qu’il n’était pas convenable que des femmes viennent s’immiscer dans la rédaction de statuts qui ne les concernent pas ! Les officiers de l’Académie, particulièrement conservateurs, se prononcent à la fin de l’année carrément pour l’exclusion des femmes.
En 1791, les réformateurs proposent un projet d’Académie « centrale » fondé sur le principe d’égalité entre tous les arts et genres, même si les femmes y ont encore un traitement spécifique : pas de droit de vote, limitation aux têtes, mains et pieds pour l’étude des modèles vivants ! La Commune des Arts ne propose pas mieux :
« L’étude est contraire aux mœurs qui conviennent aux femmes, dont la véritable vocation est d’être épouse, mère et maîtresse de maison ». Signé Restout.
En 1871, pendant la Commune de Paris, à l’assemblée générale de la Fédération des artistes, on ne relève apparemment aucun nom de femme parmi la liste des artistes élus au suffrage universel au Comité exécutif composé de quarante-six membres.
Pourtant les citoyennes comme les citoyens qui justifient de la qualité d’artistes pouvaient prendre part au vote. On ne sait pas non plus si des femmes se trouvaient parmi les quatre cents présents.
LA SAUVEGARDE DE TOUS DANS LA FRATERNITÉ
La dissolution des corporations a libéré les artistes des ateliers artisanaux mais pas des traditions. Pour permettre leur indépendance réelle, des associations se forment dès 1789. En novembre 1790, la société « Commune des arts qui ont le dessin pour base », qui est le nom complet de ce que l’on appellera plus simplement la Commune des Arts, demande, entre autres, la création d’un musée national et d’un « concours de talents à la place de la sélection par les privilèges ». L’accès de l’art à tous est soutenu par le « plan d’organisation d’une société destinée à l’avancement les sciences et des arts », rédigé à la demande de la Convention en 1793. Mais la Commune des Arts, devenue « Commune générale des Arts », est dissoute, remplacée par la « Société populaire et républicaine des Arts », qui refuse d’admettre les femmes.
La fraternité a du plomb dans l’aile, le code civil napoléonien fera le reste. À son retour d’exil, en 1801, Élisabeth Vigée-Lebrun sera sidérée de voir dans les dîners et salons en ville, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre ! Mais il restera la création d’un musée ouvert à tous et l’adoption révolutionnaire de l’enseignement pour tous en 1793 sous l’impulsion de Louis-Joseph Charlier.
En 1871, le comité des artistes élu au suffrage universel avait un mandat précis en direction du peuple :
« la mise en lumière de tous les éléments du présent ».
Pour cela, il veut créer un Officiel des arts, journal ouvert à toutes les opinions et tous les systèmes esthétiques. Il y avait aussi la « conservation des trésors du passé et la génération de l’avenir par l’enseignement ». Louise Michel, institutrice et dessinatrice, Nathalie Le Mel, libraire, ont joué un rôle important pour populariser des idées qui ne se généraliseront qu’avec la IIIe République. Après la Commune de Paris, Jules Ferry restaure l’instruction obligatoire et gratuite en 1881, laïque l’année d’après.
Cette lenteur de la société aux changements se traduira par une individualisation de plus en plus grande dans le style des artistes, ce qui entraînera une concurrence pour la célébrité et l’abandon presque total de toute fraternité dans ce domaine. Cependant les luttes du passé et leur reconnaissance permettent l’avancée toujours renouvelée de la résolution des ontradictions constitutives de tout mouvement.
EUGÉNIE DUBREUIL
Références :
Marie-Josèphe Bonnet, Liberté, égalité, exclusion. Femmes peintres en révolution, 1770-1804, Éd. Vendémiaire, 2012.
Séverine Sofio, Artistes femmes. La parenthèse enchantée, VIIIe–XIXe siècles, CNRS éditions, 2016.
La Commune et la culture, Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.
Notes :
[1] Jean-Bernard Restout (1732-1797) : issu d’une dynastie de peintres, reçu à l’Académie royale de peinture en 1769, président de la Commune des Arts en 1790.
[2] Règle, fixée en 1783, qui limite à quatre le nombre de femmes admises à l’Académie royale de peinture.