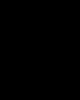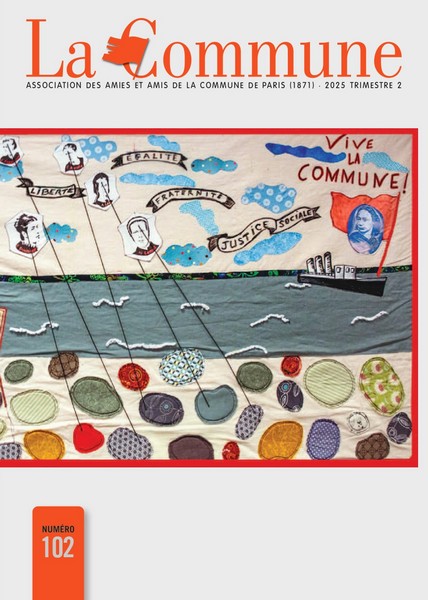Nous poursuivons notre série d’articles qui va nous conduire à 1871, en 2021…
25 juillet 1867, Londres.
Ce 25 juillet 1867, Marx écrit la préface du Capital dont la première édition, allemande, sort quelques semaines après, à Hambourg. Un livre dont il n’est guère besoin de souligner l’immense postérité. On ne saurait ici même en résumer le contenu.

Cependant, c’est pour notre propos l’occasion de reprendre la question classique de l’influence — ou de l’absence d’influence — du marxisme sur la Commune de Paris. Certes Le Capital ne fut traduit en français qu’après la Commune et on sait bien que le marxisme était très peu connu des militants français de la fin du Second Empire. Choisissons alors un autre angle d’approche.
Bien avant l’édition anglaise de 1886, la traduction française du Capital fut la première édition en langue étrangère avec la traduction russe. En effet Marx se préoccupe, dès la fin de 1867, énormément, de cette traduction, car il s’inquiète de l’influence du proudhonisme chez les ouvriers français.
Les tentatives de Marx pour faire traduire et éditer son œuvre en français nous permettent alors de découvrir un réseau de liens qui vont nous conduire à la Commune. La première tentative fut celle d’Élie Reclus. Contacté par Victor Schily, celui-ci donna son accord. Le frère du célèbre géographe se mit au travail, mais il semble que le projet échoua pour des raisons de coût du traducteur ! Il y eut aussi des démarches, sans suite, au début de 1868 auprès du Polonais Jozef Cwierciakiewicz (un émigré polonais, suite à la révolte de 1863), puis auprès de Clémence Royer, la traductrice française de Darwin, grande figure trop oubliée de la philosophie et de l’anthropologie. En octobre 1869, Marx confia la traduction à Charles Keller, qui aurait traduit 400 pages du Capital jusqu’au début de la guerre franco-allemande avant de s’interrompre. On sait aussi qu’Anna et Victor Jaclard en commencèrent la traduction (le manuscrit tombant dans les mains de la police versaillaise).
C’est après la Commune que la solution fut enfin trouvée avec l’éditeur Maurice La Châtre, dont le Dictionnaire universel avait fait la réputation. Lafargue avait servi d’intermédiaire pour négocier un contrat complexe. Le traducteur fut finalement Joseph Roy, un Bordelais qui était un proche de Longuet et Vaillant. Avec ce dernier, Roy avait travaillé, dans les années 1860, à la traduction des œuvres de Feuerbach. Le premier volume de cette édition française du Capital parut en 1872.
Retissons alors tout ce réseau ; outre les intermédiaires bien connus (Longuet, Vaillant, Lafargue), qui trouvons-nous dans ces contacts du réseau Marx en vue d’une traduction du Capital ?
Jozef Cwierciakiewicz, Polonais, insurgé de 1863, décédé en 1869 / Victor Jaclard, médecin, membre du comité central des 20 arrondissements, chef de la 17e légion fédérée, proche de Blanqui, condamné aux travaux forcés à perpétuité par contumace / Charles Keller, ingénieur, poète, membre de l’AIT, proche de James Guillaume ; habitant Mulhouse, il rejoint Paris le 10 mai 1871, blessé sur une barricade / Anna Korvin-Jaclard, intellectuelle russe, membre du comité de vigilance du 18e arrondissement, de la commission d’organisation de l’enseignement des filles, condamnée aux travaux forcés à perpétuité par contumace / Maurice La Châtre, éditeur, capitaine de la Garde nationale, journaliste au Vengeur, proche de Pyat, membre de la LURDP, condamné à la déportation en enceinte fortifiée par contumace / Élie Reclus, anthropologue, membre de l’AIT, proche de Bakounine, nommé directeur de la Bibliothèque nationale le 29 avril, condamné à la déportation en enceinte fortifiée par contumace / Joseph Roy, Bordelais, professeur de langues et traducteur, très proche de Vaillant ; on ignore s’il fut impliqué dans la Commune / Clémence Royer, philosophe et anthropologue, féministe, progressiste, non engagée pendant la Commune / Victor Schily, avocat, proche de Marx, membre de l’AIT, présent à Paris pendant la Commune, il informe Marx sur la situation.
Deux aspects nous frappent dans cette liste : d’abord, six de ces personnes sont des communards actifs. Si Marx n’influence pas, sans doute, directement la Commune, il est bien présent par ces liens qui vont au-delà de ses plus proches comme Frankel. Ensuite, la diversité est notable. Tous les courants de la Commune sont présents (républicains socialistes, blanquistes, libertaires…) voire au-delà, avec des progressistes moins engagés.
Comme la Commune, Marx voit large.
10 avril 1867, aux Tuileries
Le 10 avril 1867, « Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français » promulgue la loi adoptée le 11 mars 1867 par le Corps législatif, loi présentée par le ministre de l’Instruction publique, Victor Duruy. Des historiens voient dans cette loi un progrès sensible au regard de la loi Falloux de 1850. C’est, sans nul doute, une appréciation très exagérée. Les fondements de la loi Falloux n’étaient nullement affectés par la loi Duruy : toutes les communes n’étaient pas tenues à créer une école publique, il n’y avait aucune contrainte à la gratuité de l’enseignement, ni à son obligation ; l’enseignement des écoles publiques pouvait être assuré par des religieux, et même si elles étaient laïques, elles étaient tenues de donner un enseignement religieux sous le contrôle du clergé.

Qu’apporte la loi de Victor Duruy ? Un petit progrès concernant l’enseignement primaire des filles — la loi abaisse de 800 à 500 habitants le seuil minimum pour l’obligation faite à une commune d’avoir une école publique de filles —, et un petit progrès concernant le salaire des institutrices, en fixant un salaire minimum (inexistant auparavant) égal aux 2/3 de celui des hommes. Les communes, enfin, sont très vaguement encouragées à développer un enseignement gratuit.
Les effets de la loi sont encore discutés. Elle entraîne, sans doute, une très légère augmentation des effectifs féminins des écoles. Mais l’essentiel de l’injustice scolaire demeure à la fin du Second Empire. En 1870, un tiers des enfants de 5 à moins de 14 ans ne sont pas scolarisés, 25% des hommes et 40% des femmes (victimes d’une double injustice, sociale et de sexe) ne savent pas signer leur nom. L’accès à l’enseignement secondaire des enfants du peuple reste nul (3% des enfants en âge d’être scolarisés). De plus, l’Empire a encouragé l’enseignement catholique public ou privé. 900 nouvelles congrégations enseignantes sont autorisées ! L’enseignement primaire catholique a doublé ses effectifs et les religieuses dirigent la moitié des écoles publiques de filles !
Les visées de Victor Duruy concernant l’enseignement secondaire des filles connaissent un sort plus médiocre encore. Sa circulaire du 30 octobre 1867 crée des cours d’enseignement secondaire de filles, payant, et seulement destinés aux jeunes filles de la haute bourgeoisie. Mais elle rencontre une féroce opposition du clergé ; Mgr Dupanloup publie une brochure dénonçant cette tentative de perversion des filles ! Les cours ne connaîtront alors pratiquement aucun développement. C’est sans doute avec la création en 1868 de l’école pratique des hautes études que Victor Duruy connaît sa principale réussite, car les industriels soutiennent cette visée de développement d’une science de pointe.
Que retenir de ce voyage dans un ministère impérial ?
1- Que l’on ne peut sans nul doute résumer le Second Empire à un seul régime conservateur et autoritaire. L’essor du capitalisme français exigeait des éléments de modernisation que l’on retrouve aussi dans l’urbanisme parisien, par exemple.
2- Mais que cette modernisation n’est nullement orientée par les besoins des classes populaires ou par une quelconque visée de justice sociale, et qu’elle atteint vite, de ce fait, ses limites.
1er juin 1867, rue de Richelieu

Chez l’éditeur d’art Alfred Cadart, dans les salles d’exposition vides, sur la table, manuscrits et cornets de frites : on prépare, autour de Jules Vallès, le premier numéro de La Rue.
La Rue — Nous avons pris son nom pour pavillon afin de bien indiquer d’un coup qui nous sommes. Nous voulons être le journal pittoresque de la vie des rues et écrire simplement, au courant du flot qui passe, les mémoires du peuple. (…) Nous allons les tirer les uns et les autres de l’ombre, les traîner hideux ou désespérés à la face du ciel.
Ce 1er juin 1867, Jules Vallès présente ainsi le jeune journal, où, précise-t-il,
nous attaquerons toutes les aristocraties.
L’Empire libéral ? Mais quelques semaines après, Vallès veut écrire un article intitulé « 1867 » ;
Nous avions sous ce titre, passé en revue les hommes et les choses de l’année, allant du Mexique à la Porte-St-Martin.
L’article est censuré. « Nous restons donc là la bouche ouverte, le poing coupé. » Puis c’est la condamnation et la fin du journal, après 33 numéros, le 11 janvier 1868.
Libéral l’Empire !
JEAN-LOUIS ROBERT