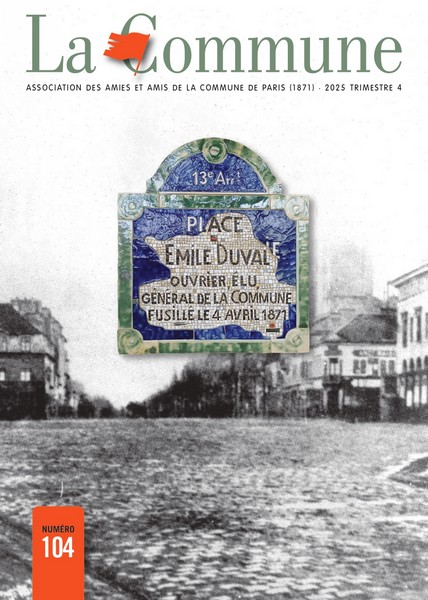IMAGE DU SIÈGE DE PARIS
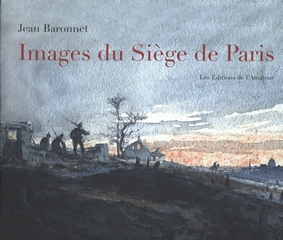 Les 224 pages que Jean Baronnet a publiées en 2010 aux éditions de l’Amateur constituent un bon ouvrage de référence iconographique sur le Siège de Paris.
Les 224 pages que Jean Baronnet a publiées en 2010 aux éditions de l’Amateur constituent un bon ouvrage de référence iconographique sur le Siège de Paris.
Certes, cet ouvrage n’est pas exhaustif, mais il est impossible de l’être, compte tenu du nombre des documents disponibles. L’auteur a fait le choix de privilégier le croquis sur la peinture de chevalet : parmi tous les modes de représentation, « nous avons choisi les plus spontanés, les plus proches de ce que nous demandons aujourd’hui à la photo de reportage ; ce sont les carnets de croquis (sketches en anglais) qui, plus que les peintures d’atelier, décrivent la vie quotidienne, comme l’ont fait certains des auteurs cités dans ce livre ». On aurait souhaité tout de même y trouver davantage de photographies.
La présentation en est des plus simples car elle est rigoureusement chronologique : elle suit le Siège jour après jour, sans en sauter un. Les commentaires ne sont pas toujours très rigoureux et sont parfois même quelque peu anachroniques, comparant des évènements de 1870 à d’autres qui leur sont bien postérieurs.
Par contre, l’auteur donne très souvent la parole à des écrivains contemporains du Siège : Edmond de Goncourt, le comte d’Hérisson, Victor Hugo, Édouard Manet, Jules Vallès, Théophile Gautier, Félix Pyat...
Ces citations donnent incontestablement un intérêt supplémentaire à l’ouvrage : on peut saluer là une initiative très louable de Jean Baronnet.
En définitive, les Images du Siège de Paris prennent une place tout à fait convenable parmi les ouvrages de référence iconographique sur le Siège : les curieux, les historiens et les chercheurs pourront le consulter avec profit.
Georges Beisson
Les éditions de l’Amateur, 2010.
LES BRETONS ET LA COMMUNE DE PARIS 1870-1871
 L’ouvrage est conduit comme un récit historique de près de 400 pages sur les années 1870 et 1871. Il est accompagné, à la façon d’une thèse universitaire de références utiles aux chercheurs, liste des Bretons liés aux événements, bibliographie, index et liste des lieux de mémoire. Il nous conforte un peu dans l’idée que les Bretons sont d’abord des Bretons, ce qui peut faire leur force autant que leur faiblesse comme le reconnaît l’un d’entre eux : « tous ou presque tous, nous avons contribué à amener la catastrophe finale » (p.13).
L’ouvrage est conduit comme un récit historique de près de 400 pages sur les années 1870 et 1871. Il est accompagné, à la façon d’une thèse universitaire de références utiles aux chercheurs, liste des Bretons liés aux événements, bibliographie, index et liste des lieux de mémoire. Il nous conforte un peu dans l’idée que les Bretons sont d’abord des Bretons, ce qui peut faire leur force autant que leur faiblesse comme le reconnaît l’un d’entre eux : « tous ou presque tous, nous avons contribué à amener la catastrophe finale » (p.13).
L’auteur, Charles des Cognets, dédie d’ailleurs son livre aux Bretons qui « la Commune venue, soutinrent l’un ou l’autre camp en luttant généreusement pour leurs convictions et leurs idéaux » ! Il a rencontré les descendants de nombreux acteurs des familles de Keratry, Mahé de la Villeglé, Bourboulon, de Mun, de Ploeuc et Rossel.
Quelques belles figures participantes à la Commune se dégagent comme celle de Jules Suisse, dit Jules Simon, suspendu de ses fonctions de professeur de philosophie à la Sorbonne dès le coup d’Etat napoléonien du 2 décembre 1851, député républicain sous l’Empire, ministre de l’Instruction publique dans le gouvernement de la Défense nationale en septembre 1870, élu de nouveau député en 1871, ministre de l’Instruction pendant la Commune ( Edouard Vaillant est délégué à l’enseignement le 20 avril 1871 en remplacement de Jules Vincent) et farouche adversaire de « l’Ordre moral » tout au long de sa carrière d’homme politique.

- Nathalie Le Mel
Il y a bien sûr aussi la belle figure volontaire à l’inamovible petite coiffe bretonne de Nathalie Le Mel, fille d’ouvriers, libraire socialiste à Quimper puis à Paris après avoir épousé Adolphe Le Mel, ouvrier relieur.
Rappelons son engagement à l’Internationale avec Varlin, son restaurant social, La Marmite, la création de l’Union des femmes pour la Défense de Paris avec Elizabeth Dmitrieff et sa nomination à la Commission d’enquête et d’organisation du travail dirigée par Léo Fränkel. Arrêtée en juin 1871, elle sera déportée en Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel et Henri Rochefort avant d’en revenir gravement malade à l’amnistie.
Il y a aussi le malheureux Louis Rossel, un des chefs militaires de la Commune, fusillé par les Versaillais.
Parmi les autres Bretons célèbres, les généraux Jules Trochu et son ami Adolphe Le Flô, n’iront pas jusqu’au bout de leur engagement, malgré de belles critiques du régime impérial au risque de leur carrière. Trochu préside le gouvernement de Défense nationale avec Le Flô comme ministre de la Guerre, mais commet des erreurs dont le résistant Rol-Tanguy, dans un article intitulé Les aspects militaires de la Commune, ne le tient pas quitte : « Par incapacité et par calcul, le gouvernement présidé par Trochu refuse à la fois l’amalgame et l’action d’ensemble...Trochu va ou bien laisser ces forces parisiennes, sciemment, dans l’inaction, en particulier la Garde nationale, ou bien les faire battre en détail jusqu’à l’armistice. Au lieu d’amalgamer les troupes d’origine diverses, il maintient trois formations distinctes : l’armée active, les mobiles et les civils armés, c’est-à-dire la Garde nationale sédentaire » [1].
Parmi les Bretons « les plus Médiatiques » on peut encore citer Charles Beslay, militant social, Emile de Keratry qui marche vers l’Hôtel-de-Ville en 1870, Constant Le Moussu, Jean-Louis Pindy, ouvrier menuisier et Alexandre de Ploeuc, mais bien évidemment beaucoup restent dans l’ombre encore qui, selon l’auteur, consensuel, contribueront à la renaissance définitive de la République.
Eugénie Dubreuil
éd. l’Harmattan.
 L’historien du mouvement ouvrier Michel Cordillot se penche une nouvelle fois sur l’émigration politique des Français aux Etats-Unis, tout au long du XIXe siècle, qui a marqué durablement le mouvement social francophone.
L’historien du mouvement ouvrier Michel Cordillot se penche une nouvelle fois sur l’émigration politique des Français aux Etats-Unis, tout au long du XIXe siècle, qui a marqué durablement le mouvement social francophone.
Entre 1848 et 1870, ce sont plusieurs milliers de réfugiés utopistes, démocrates ou révolutionnaires qui s’installent outre-Atlantique. Les communards sont donc loin d’être les seuls francophones à avoir émigré dans ce pays neuf. Deux vagues d’exil largement méconnues les ont en réalité précédées.
Cabétistes et Fouriéristes sont les premiers militants à l’appel de leurs dirigeants (E. Cabet et V. Considérant) à s’installer aux Etats-Unis. Porteurs d’un projet de régénération sociale, ils rêvent de fonder une société communautaire idéale. Les expériences de colonie agricole se multiplient alors au cœur de l’Amérique profonde (Texas, Missouri). Les scissions sont fréquentes et les expériences souvent de courte durée.
A la même époque, les proscrits de la IIe République fuient, eux, les espoirs déçus de 1848 et le coup d’Etat de 1851. Ils se regroupent dans les villes, à New-York et à La Nouvelle-Orléans.
Acteurs importants du mouvement socialiste franco-américain, ils fondent l’Union républicaine de langue française et adhèrent aux sections de l’AIT. La proclamation de la République, en septembre 1870, encourage le retour en France de nombreux réfugiés, prêts à défendre la patrie, et suscite un mouvement de soutien dans l’opinion publique américaine.
Enfin, les communards se réfugient essentiellement à New-York, après la répression sanglante de la Commune. Dominés par les blanquistes, ils se mêlent à la communauté d’exil francophone en animant des journaux et une Société des réfugiés qui célébra chaque année l’anniversaire du 18 mars. L’amnistie de 1880, selon Michel Cordillot, clôt véritablement une époque.
ERIC LEBOUTEILLER
Michel Cordillot, Utopistes et exilés du Nouveau Monde. Des Français aux Etats-Unis de 1848 à la Commune, Paris, Vendémiaire, 2013.
 François Camille Cron aurait pu rester un communard anonyme si ses descendants n’avaient pas, longtemps plus tard, découvert ses Souvenirs amers, un manuscrit dans lequel il raconte sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Il dédie ses mémoires à son fils Philippe et « espère qu’un jour viendra où il pourra profiter, ainsi que des observations qu’il ajoutera si le temps le lui permet, ainsi que son idéal politique et moral ». Mais le fils mourra avant d’avoir lu le témoignage de son père. Capitaine adjudant major d’une compagnie de marche de la Garde nationale, François Cron participe aux plus durs combats de la Commune à Neuilly, Asnières, Rueil, Courbevoie, Levallois-Perret. Il est présent sur les dernières barricades de son quartier des Buttes-Chaumont, mais il échappe à la répression.
François Camille Cron aurait pu rester un communard anonyme si ses descendants n’avaient pas, longtemps plus tard, découvert ses Souvenirs amers, un manuscrit dans lequel il raconte sa déportation en Nouvelle-Calédonie. Il dédie ses mémoires à son fils Philippe et « espère qu’un jour viendra où il pourra profiter, ainsi que des observations qu’il ajoutera si le temps le lui permet, ainsi que son idéal politique et moral ». Mais le fils mourra avant d’avoir lu le témoignage de son père. Capitaine adjudant major d’une compagnie de marche de la Garde nationale, François Cron participe aux plus durs combats de la Commune à Neuilly, Asnières, Rueil, Courbevoie, Levallois-Perret. Il est présent sur les dernières barricades de son quartier des Buttes-Chaumont, mais il échappe à la répression.
François Cron réapparaît en novembre comme contremaître de l’usine de scierie de marbre des Récollets, quai de Jemmapes, dans le Xe arrondissement. « J’étais très heureux, entouré de ma bonne femme et de mes quatre enfants », écrit-il. Mais le bonheur sera de courte durée. En 1873, une lettre anonyme parvient à l’usine des Récollets. Un cas isolé ? Non, durant ces années troubles, 400 000 lettres (selon la préface) seront adressées à la police pour dénoncer des communards !
Le 14 février 1874, le contremaître scieur est arrêté à son travail. Après un séjour à la prison des Chantiers, le 3 mars, le IVe Conseil de guerre de Versailles le condamne à la déportation simple. Le 29 août 1873, François Cron embarque à bord de « La Virginie » à destination de la Nouvelle-Calédonie. Cinq mois plus tard, le matricule 2834 débarque sur l’île des Pins. Il subira trois années de solitude « sur cette terre lointaine et inhospitalière ». « Ici rien pour vous distraire, pas de nouvelles du monde, rien que la vue de nos misérables cahutes, quelques arbres, la mer et le chiendent qui pousse à foison. Oui les gens de l’Ordre moral ont bien choisi le lieu de déportation », écrit-il dans son cahier bleu.
Le 10 novembre 1876, sa peine est commuée en dix années de bannissement. Le 17 mai de l’année suivante, il embarque à bord du « Tage ». Interdit de séjour en France, l’ancien communard gagne sans doute l’Alsace, où résident sa femme et ses enfants.
On perd sa trace jusqu’en 1891, où il tient une petite papeterie dans le quartier des Buttes-Chaumont. Il meurt à Paris en 1902.
John Sutton
Mémoires de François Cron, déporté de la Commune, éd Mercure de France (2013).
SOUVENIRS D’UN RÉVOLUTIONNAIRE
 Gustave Lefrançais (1826-1901) a été, à 44 ans, le premier président élu de la Commune de Paris. C’est l’aboutissement d’une vie militante depuis février 1848 où il prend « part aux efforts communs pour hâter la délivrance » du peuple opprimé.
Gustave Lefrançais (1826-1901) a été, à 44 ans, le premier président élu de la Commune de Paris. C’est l’aboutissement d’une vie militante depuis février 1848 où il prend « part aux efforts communs pour hâter la délivrance » du peuple opprimé.
Ses souvenirs, publiés à l’origine en feuilleton sous la IIIe République couvrent presque une trentaine d’années avec la volonté de montrer, à l’usage des jeunes, comment se forme une conscience révolutionnaire. A l’aide des journaux, des clubs, des associations, des répressions aussi qui vont de la prison à l’exil londonien dès 1851, sa résistance se radicalise. Après la formation, l’action, la création de coopératives ouvrières, puis les luttes contre la peine de mort, pour l’union libre, il est tenté un moment par les Francs-maçons, mais préfère finalement l’Internationale des travailleurs. Les pages consacrées à l’analyse des rivalités à l’intérieur du Comité de salut public de la Commune et, ensuite, au bombardement de Paris par « les lingots lancés par les boîtes à mitraille » seront particulièrement appréciées par nos lecteurs.
Eugénie Dubreuil
Préface de Daniel Bensaid, éd. La Fabrique, 2013 (réédition).