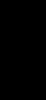Ils vécurent différemment la liberté surveillée qui leur était octroyée. Bauër, à qui « les 153 jours de traversée, les contacts forcés, les voisinages inévitables » avaient enseigné « le prix de la solitude », ne tarda pas à se faire construire une case par un menuisier qu’il nomme Carbonnel dans ses Mémoires d’un jeune homme. Le « repas baptismal », probablement trop arrosé, se termina en pugilat :
Vous êtes un bourgeois…, un bourgeois…, rien que bourgeois !
Vous ne savez pas ce que vous dites, Carbonnel : je suis révolutionnaire, socialiste et proudhonien comme vous ; j’ai combattu pour la Révolution aussi bien et peut-être mieux que vous. Si ma case vous offense, il ne fallait pas la construire !
Je vous répète que vous êtes un fils de bourgeois, d’exploiteurs, de voleurs, et vous vous payez des maisons avec les vols de vos pères.
Ils en viennent aux mains, et il faut les séparer.

Après l’évasion de Rochefort et de ses compagnons, Bauër fut moqué d’avoir été « laissé en plan », abandonné « comme un bagage encombrant » :« Altercation stupide », avec « un brave homme, un camarade avec lequel s’accordaient d’ordinaire mes sentiments », écrit Bauër de celui qu’il a frappé au visage. Son aîné de 20 ans lui « députe » le lendemain ses témoins, alors que « ni son éducation ni ses habitudes ne le prédisposent au Duel ». De fait, Charbonneau, atteint au cou par une des piques qu’avait forgées Assi, aurait conclu : « Cela devait être ; le bourgeois ne pouvait manquer de blesser l’ouvrier ! » Était renvoyé à sa classe d’origine celui qui avait écrit, le 23 février 1871, dans le Cri du Peuple de Vallès :
Au milieu de l’effondrement successif de nos libertés et de notre honneur, un parti […] est resté à son poste de combat, c’est le parti des travailleurs, c’est le parti des déshérités, c’est le parti de l’avenir. Ce doit être le nôtre, à nous qui avons vingt ans.
C’est cruel, compatit Joannès Caton dans son Journal d’un déporté, car voici ce pauvre garçon déjà assez malheureux d’avoir perdu les seuls compagnons avec lesquels ses goûts, ses habitudes lui permettaient de frayer. Car ils étaient bourgeois comme lui, mal à l’aise, se sentant eux-mêmes déplacés au milieu de cette population presque exclusivement ouvrière, simple et d’allures ouvertes.
Bauër, qui fit d’ailleurs l’objet d’une surveillance accrue, bénéficia du soutien amical de Gaston Caulet de Tayac : ce collaborateur du journal de Vallès, dépêché à Lyon par Raoul Rigault, avait été arrêté lors de la brutale répression de l’insurrection de la Guillotière, ultime tentative pour sauver l’expérience communale rhodanienne, les 30 avril et 1er mai 1871.
Sur la presqu’île Ducos vivaient, aux côtés de près de 900 « fortifiés », quatorze femmes, dont Marie Pervillié, femme Dupré, qui, condamnée à la déportation simple, comme son mari, avait refusé de l’accompagner à l’île des Pins. « Gentille, douce et affectueuse », cette « lingère…, une grisette » devint la maîtresse de Bauër :
Elle m’a aimé, la chère amie des tristes jours ; elle a bravé l’opinion publique, le reproche d’élire un petit bourgeois au milieu de tant de plébéiens, et, ingrat, égoïste, je n’ai senti d’amour pour elle qu’après son abandon.
Leur idylle dura d’avril 1874 à juin 1876, et Louise Michel en fut le témoin, consolant l’une, prodiguant des conseils de « mère » à l’autre :
Je sais bien que, si pendant quatre ou cinq ans encore, elle s’attachait à vous et qu’elle vous voie vous marier après, le coup serait trop dur, et qu’il est, en même temps, inévitable…
Il n’y eut pas mésalliance, et la femme Dupré, « dans le plus grand dénuement », dut solliciter le soutien financier de la « bonne Louise » en 1893.

Par une lettre à Mac-Mahon datée du 12 juillet 1876, Bauër le pria de bien vouloir commuer sa peine en bannissement. Il se plut à espérer qu’une « décision gracieuse pourrait atteindre un jeune homme qui a sa vie à commencer » et qui, « emporté par l’irréflexion de la jeunesse, entraîné par des idées chimériques, dont le temps et la réflexion se sont chargés de [lui] démontrer l’inanité, [avait] eu le malheur de prendre part – dans une mesure très secondaire, il est vrai – aux faits insurrectionnels ». Fut-il encouragé dans cette démarche par sa mère qui venait d’être expulsée de Nouméa, le 20 mai, après y avoir séjourné quinze mois ? Il ne fait pas la moindre allusion à sa présence, et se justifie par le désespoir qui l’avait envahi à l’annonce du rejet massif du projet de loi d’amnistie par l’Assemblée, le 18 mai.
Une note de synthèse de la censure militaire, du 12 novembre 1876, révèle que la multiplication des recours de « plusieurs des plus gravement compromis sous la Commune […] irrite quelques-uns de ceux qui se considèrent comme leurs victimes ». Et de citer l’extrait d’une lettre de Pierre Charbonnau [sic], qui exprimait son dépit :
Il y a huit jours, on appelait pour des renseignements tous les nouveaux ”recoureurs”, parmi lesquels se trouvent les Bauër [et autres], tous ces grands citoyens qui jadis jetaient à la face des malheureux, c’est-à-dire des irresponsables, que celui qui est vaincu défendant un principe ne doit demander aucune grâce ni faveur à son vainqueur sous peine de faillir à l’honneur, de devenir lâches et hypocrites. Ont-ils changé d’avis ?
Ce refus de toute compromission nous est confirmé par le forgeron Malzieux qui vécut tout aussi douloureusement que nombre de ses camarades s’abaissassent à prier le maréchal-président de commuer leur peine, « des hommes que leurs ambitions devraient défendre de toutes faiblesses, des gueulards. Une chose me console, écrit-il à André Léo, le 11 mai 1878, aucun de mes amis (je parle des socialistes, Delacour, Charbonneau, Danière) n’ont bronché en rien, ils savent que nous sommes le droit et la justice. »
Bauër fut informé, le 31 mars 1877, que « le recours en grâce n’avait pas paru susceptible d’être accueilli » Sa case n’ayant pas résisté au cyclone du 23 février 1876, il s’en était fait construire une autre, où il vécut pendant deux années dans la seule compagnie de sa bibliothèque, riche d’une centaine d’ouvrages.
J’ai déchu, confesse-t-il dans son autobiographie. Le blâme que j’infligeais aux autres en pareille occurrence retombe lourdement sur moi et m’humilie. Demander grâce…, moi qui jugeais avec une telle hauteur de mépris, si impitoyablement, les camarades coupables de semblable capitulation ! J’en ai écarté de moi la pensée honteuse, mais elle est revenue et m’a hanté : elle m’a imposé l’espoir de respirer, de revivre, d’être un homme enfin – et j’ai succombé à la tentation ! […] À mes côtés, des plébéiens, des ouvriers honnêtes et dignes, qui n’ont ni l’aide morale de l’instruction, de la lecture, ni aucun adoucissement matériel, m’offrent l’exemple de la fermeté et de l’intransigeance. Comme les qualités robustes de ces hommes du peuple résistent à l’épreuve ! Comme leur conviction énergique est supérieure aux enthousiasmes passagers, à la fougue désordonnée d’un jeune bourgeois trop vite amolli.
Le 30 avril 1879, le ministre de la Marine s’étonna auprès du garde des Sceaux que Charbonneau n’eût été l’objet d’aucune remise de peine, alors que huit des neuf déportés récompensés à l’Exposition Universelle de Paris de 1878 avaient été compris dans le décret du 15 janvier 1879. En dépit de la médaille de bronze qui lui fut attribuée pour la réalisation d’une bibliothèque, ce « menuisier en meubles sculptés » n’avait bénéficié d’aucune mesure d’indulgence puisqu’il s’était toujours refusé à former le moindre recours. Il fut néanmoins atteint par une décision gracieuse le 8 mai 1879, et, à son retour en France par La Loire, il se remit à son établi après avoir accusé réception de son certificat de libération en mars 1880.

Bénéficiaire de la loi d’amnistie partielle, après une ultime supplique de sa mère, apostillée par Victor Hugo, Bauër quitta Nouméa le 19 juillet 1879. Deux députés, du Jura et du Var, se portèrent « garants […] d’une conduite plus conforme à son éducation […] et de son respect pour le gouvernement qui a daigné substituer la clémence protectrice à l’expiation. » Le fils naturel d’Alexandre Dumas se signala désormais par son activité de journaliste, notamment de critique théâtral, qui lui apporta la gloire et la fortune. Les Archives nationales conservent deux lettres qu’il adressa à Charbonneau : la première, en 1894, pour regretter, alors qu’il s’était « donné tous les torts dans cette triste affaire », que son destinataire, « compagnon des mauvais jours », ait été blessé par le compte rendu qu’il avait fait de leur rencontre sur le pré dans l’Écho de Paris ; la seconde, en 1899, pour l’inviter à découvrir, dans son volume de souvenirs, combien « le petit bourgeois, naguère rempli de préjugés, […] est devenu en vieillissant un homme libre. Mieux vaut tard que jamais ! »
Dix ans avant Bauër, Charbonneau mourut en 1905 dans la misère, fidèle à sa classe qui « produit et souffre » et convaincu que « les fils de la bourgeoisie qui se sont mêlés à la Commune n’y ont pas pris part dans le même esprit que les prolétaires ». Alors que ces derniers combattaient pour leur « émancipation économique », les bourgeois, « produits de cette organisation capitaliste », ne voyaient « dans le mouvement insurrectionnel qu’un but politique » et, en dépit du « sentiment de justice » qui avait pu les « dégager, dans une certaine mesure, de l’éducation reçue », ils demeuraient des bourgeois. Ainsi, lorsque Descaves lui rendit visite dans son « indigent réduit », l’octogénaire Nathalie Le Mel agitait encore « ce haillon de divorce, rapporté du bagne » et pouvait s’autoriser à conclure au terme d’une longue vie militante :
Quelle chimère que la fraternité !
YANNICK LAGEAT