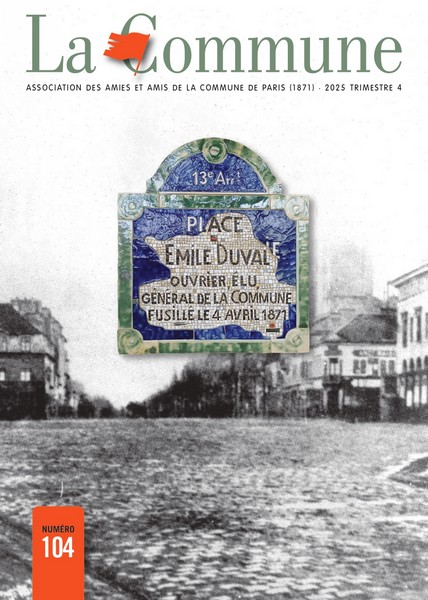Déjà l’article 16 du Code noir de 1685 [1], repris mot pour mot dans l’article 13 du Code noir de 1724 [2], stipulait :
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus les contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre lesdits contrevenants encore aucun décret.
Les prolétaires ne sont guère mieux traités au XIXe siècle que les esclaves aux XVIIe et XVIIIe. L’article 291 du Code civil napoléonien, né avec le siècle [3], stipule, en effet, que
la fondation de toute association de plus de vingt personnes visant à s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres est soumise à l’agrément du gouvernement, sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société.
Cet article, aboli seulement en 1901, fait donc la loi pendant exactement tout le XIXe siècle en étouffant la liberté d’association.
Ce n’est que lors de quelques moments privilégiés de l’Histoire — ceux des Révolutions — que le peuple parvient à se faire entendre directement : en 1793, en 1848, en 1871, en 1968…
En 1871, sous la Commune, les clubs, lieux privilégiés de l’expression populaire, sont particulièrement nombreux et actifs, mais ils n’ont pas été créés ex nihilo : héritiers des clubs révolutionnaires de 1793 et de 1848, ils assurent en ligne directe la continuité avec les réunions publiques de la période 1868-1871, plus ou moins tolérées à la suite du vote de la loi du 6 juin 1868.
Dans les années soixante, Napoléon III cherche, en effet, à se concilier le monde ouvrier pour contrebalancer son opposition libérale, celle des républicains et des orléanistes. L’empereur pense aussi qu’en faisant des ouvriers des patrons, il les ouvrira à la société moderne et les rendra favorables au capitalisme. Il leur accorde successivement le droit de coalition (loi du 25 mai 1864), qui permet la grève mais sans que celle-ci puisse être structurée en raison de l’impossibilité de se réunir, et le droit de fonder des Sociétés à capital variable, c’est-à- dire des coopératives (loi du 25 juillet 1867), là encore difficiles à organiser sans réunions. Napoléon III se laisse alors convaincre de la nécessité d’assouplir la réglementation des réunions publiques.
C’est l’objet de la loi du 6 juin 1868, encore toutefois bien restrictive. La disposition essentielle consiste à remplacer l’autorisation par une simple déclaration, effectuée trois jours à l’avance par sept citoyens qui en précisent le lieu, le jour, l’heure et l’objet. Cependant : les sujets politiques et religieux sont exclus ; les réunions doivent avoir lieu dans un local clos et couvert ; elles se tiennent sous la responsabilité d’un bureau — un président et deux assesseurs — gardien de l’ordre du jour et chargé d’empêcher les dérapages ; surtout, « l’administration peut déléguer un fonctionnaire — en fait, le commissaire du quartier, assisté d’un secrétaire et, plus tard, également d’un sténographe — doté du pouvoir de dresser le procès-verbal des faits, d’adresser des avertissements au bureau en cas de trop grande tolérance, et de dissoudre la réunion » ; enfin, de lourdes peines sont prévues pour les contrevenants et délinquants. La loi additionne, en effet, la rigueur de ces deux catégories de peines : le tribunal correctionnel est compétent, l’existence de l’infraction compte seule et non l’intention, les peines peuvent être cumulées.

La loi de 1868 a permis en fait, malgré un lourd contentieux et de très nombreuses condamnations, un développement sans précédent des réunions publiques.
Entre la parution de la loi et sa suspension en avril 1870 et en excluant les périodes électorales, 933 réunions publiques sont organisées dans 73 salles, bien réparties entre le centre (28), la périphérie (37) et la banlieue (8) de Paris [4]. Elles mobilisent des milliers de participants et des dizaines d’orateurs. Le 3 mars 1869 marque un record : on estime entre 10 000 et 15 000 le public réuni ce jour-là dans sept salles différentes [5]. Le public est très diversifié : habitants du quartier ou Parisiens venus d’autres arrondissements parce qu’ils sont attirés par l’ordre du jour, bourgeois, ouvriers, étudiants. Les femmes y assistent en grand nombre et même les enfants. Le mouvement est rapidement très bien structuré. Entre 25 et 30 meneurs apparaissent, organisateurs ou orateurs, tantôt habitués à une salle, tantôt en fréquentant plusieurs. Ils sont de tendances très diverses : « économistes » (Horn, Molinari, Passy, Simonin), catholiques (Lenormant, Récamier), protestants (Montandon, Pressensé), blanquistes (Duval, Ferré, Peyrouton, Rigault), radicaux et jacobins (Guyot, Lissagaray), membres de l’AIT [6] (Amouroux, Fribourg, Héligon, Nostag, Tolain, Varlin).
Ces derniers prennent de plus en plus la vedette et donnent incontestablement une orientation socialiste au mouvement ouvrier et une dynamique révolutionnaire, préfigurant la Commune, aux Parisiens. Les réunions publiques, qui se tiennent régulièrement dans les mêmes salles avec des ordres du jour souvent voisins, voire permanents, sont de facto devenues des clubs : l’association est bien le corollaire de la liberté de réunion !
Ces clubs sont des noyaux de résistance et d’offensive puisque les mouvements des 31 octobre 1870 et des 6 et 22 janvier 1871 y prennent naissance. Les réunions publiques seront, de ce fait, interdites de mai 1870 au 4 septembre 1870, puis de janvier 1871 au 18 mars 1871. Elles reprennent après le 18 mars, sous l’égide des clubs de la Commune. L’un d’entre eux, particulièrement bien documenté, mérite une étude particulière : le Club des prolétaires.
Le Club des prolétaires est le club de la Commune le mieux connu, d’une part parce qu’il est le seul à avoir fait l’objet de documents écrits — procès-verbaux de séances, dossiers individuels de militants traduits devant le Conseil de guerre — et d’autre part parce qu’il publiait un journal, Le Prolétaire, dont quatre numéros ont paru entre le 10 et le 24 mai et sont conservés. Ce journal se présente comme « un organe de revendication sociale, afin que ceux qui ne peuvent pas s’expliquer à la tribune puissent le faire par écrit ». Il ne faut pas, affirme-t-il, « laisser les membres de la Commune s’isoler de leurs mandants ».
Le Club des prolétaires se réunit à l’église Saint-Ambroise qui vient d’être construite sur le boulevard du Prince Eugène, ancien nom du boulevard Voltaire. Pendant le siège de Paris, elle abrite le Club Saint-Ambroise qui donne naissance après le 18 mars et donc sous la Commune au Club des prolétaires, fondé par le maçon David, militant des sociétés ouvrières de production, membre de l’association internationale des travailleurs et blanquiste. David est entouré d’une équipe organisatrice où se retrouvent notamment des membres du sous-comité du XIe arrondissement. L’église est dévolue au culte dans la journée et occupée le soir par le club. Le club a pour vocation de « faire l’éducation du peuple par le peuple » et d’« exprimer les revendications du peuple les plus pressantes : instruction gratuite, horaires de travail allégés, salaire minimum ». Il rassemble chaque soir des milliers de personnes dont un très grand nombre de femmes. Quatre mille personnes assistent à la sixième réunion. On décide alors, le 15 mai, d’ouvrir un second club à l’église Sainte-Marguerite.
La documentation disponible présente un second intérêt, celui de pouvoir mettre en parallèle les conceptions de l’équipe dirigeante et celles des citoyens de base.
L’équipe organisatrice comprend, outre David : Jean Parthenay, ébéniste ; Jacqueline, métreur vérificateur, international et blanquiste ; Baillehache, typographe ; Baux, ouvrier mécanicien et international ; Jules André, fabricant de carreaux ; Charles Lesueur, peintre ; Claudius Favre, doreur et international. Elle a en main le journal et ses membres prennent très souvent la parole, mais ils n’en ont pas le monopole. De simples participants comme l’ébéniste Sylvain, la blanchisseuse André ou la veuve Thiourt, se révèlent être d’excellents tribuns.

Les préoccupations essentielles des animateurs, telles qu’elles apparaissent dans leurs prises de paroles et dans les deux tribunes du Prolétaire, la Tribune des égaux et Notre tribune, sont de défendre la République, de reprendre en main l’œuvre inachevée de 1789 et surtout de bien contrôler les membres de la Commune. « La souveraineté populaire ne se délègue pas ». « L’élu est révocable et doit être prêt à rendre compte ». Très anticléricaux, ils défendent, par ailleurs, l’instruction primaire gratuite et obligatoire, la justice gratuite et démocratique, la limitation des horaires de travail, le salaire minimum. Les participants de base sont pour la plupart des habitants du quartier Popincourt situé au cœur des faubourgs ouvriers. Ils sont essentiellement préoccupés par les problèmes quotidiens et notamment par la situation militaire. Ils se montrent volontiers intransigeants et sont souvent partisans de solutions extrêmes : révocation de certains officiers, poursuite des réfractaires, exclusion des religieux des écoles et des hôpitaux, expropriations, exécution des otages.
Le Club des prolétaires n’est toutefois que l’un des vingt-huit clubs de la Commune qui ont pu être recensés. Beaucoup d’entre eux se sont installés dans des églises : le Club de la Révolution à Saint Bernard (XVIIIe) ; le Club de la révolution sociale à Saint Michel des Batignolles ; le Club de la victoire à Saint Sulpice ; le Club Nicolas des Champs à l’église du même nom.
Le décret du 2 avril 1871 instituant la séparation de l’État et de l’Église a permis, en effet, de résoudre de manière élégante le problème des salles de réunion. Avant 1871, il était difficile de trouver des salles. Celles qui ont été utilisées étaient des salles de bal, de café-concert, de théâtre, de marchands de vin, voire des cirques, des gymnases, des écuries, des séchoirs et même les catacombes. Mais leur capacité n’était pas toujours suffisante, leur location était onéreuse et les propriétaires n’étaient pas toujours fiables : craignant des incidents ou simplement les autorités, il leur arrivait de se rétracter. Ils étaient, par ailleurs, à la merci du retrait de l’autorisation accordée par la préfecture de police, qui ne s’en privait pas. Les possédants n’éprouvaient, par contre, aucun problème pour se réunir en privé, au cours d’agapes, et protégés par le principe d’inviolabilité du domicile !

À cette époque qui ne connaît ni l’Internet, ni la télévision, l’essentiel de l’information est assuré par la presse — dont les citoyens sont de grands consommateurs, mais qui n’est pas toujours indépendante et dont la liberté pose problème — et par les réunions publiques. Notons en passant que la forme même de ces moyens de communication mène aux échanges entre citoyens et à l’action, alors que les médias contemporains, qui touchent l’individu dans son isolement quotidien sous la forme de contacts intimes avec un appareil électronique alimenté par le pouvoir, le conduisent automatiquement à la passivité.
Les clubs sont avant tout des lieux d’information, d’éducation populaire et d’expression de la pensée des citoyens de base. « C’est à nous que revient l’initiative », affirment-ils. De fait, les clubs ont été souvent à l’origine de propositions qui ont été adoptées par le Conseil de la Commune, mais ils étaient aussi souvent très critiques et remuants.
Les clubs communards présentent en définitive une grande originalité : ouverts à tous, ils diffèrent de nos partis politiques ; tournés vers l’action, ils diffèrent de nos « clubs de réflexion ». Ils témoignent en fait de la responsabilité citoyenne de la population de l’époque, de sa curiosité des mécanismes économiques et sociaux, et de sa maturité politique.
GEORGES BEISSON
Notes
[1] Édit du Roi (Louis XIV) touchant la Discipline des esclaves nègres des Isles de l’Amérique française, Donné à Versailles au mois de Mars 1665.
[2] Édit du Roi (Louis XV) touchant l’État et la Discipline des esclaves nègres de la Louisiane, Donné à Versailles au mois de Mars 1724.
[3] Il a été promulgué le 21 mars 1804.
[4] Alain Dalotel, Alain Faure, Jean-Claude Freiermuth, Aux origines de la Commune, Le mouvement des réunions publiques à Paris 1868-1870, Paris, François Maspero, « Actes et mémoires du peuple », 1980, p. 54-75.
[5] Alain Dalotel..., Idem, p. 124.
[6] Association internationale des travailleurs, fondée à Londres le 28 septembre 1864.