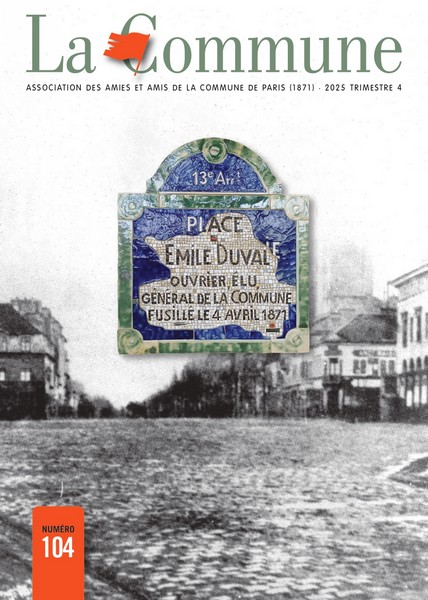Durant la Commune, il avait fondé deux journaux, la Montagne, qui connut 22 livraisons, puis le Salut Public, dont la publication débuta le 16 mai pour s’interrompre, dès le 23, après l’entrée des troupes versaillaises dans Paris.
Peut-on parler d’un « accès de fièvre » qui aurait atteint, « dans le funèbre printemps de 1871 », celui qui fut « poète à 17 ans, soldat patriote à 20 ans » ?
En l’occurrence, Victor Hugo semble s’être mépris sur la profondeur des convictions de celui qui s’était recommandé très tôt à son attention.

Gustave Maroteau, natif de Chartres, avait prolongé ses études au lycée Louis-le-Grand, avant de se décider à vivre de sa plume. « Il m’est arrivé, écrit Vallès dans l’Insurgé, un jeune homme de 16 ans, à la figure maladive, avec des airs de fille, mais avec l’ossature faciale d’un gars à idées et à poil », que sa mère avait poussé à solliciter « l’aumône d’une auscultation littéraire ». Les encouragements n’avaient pas manqué, puisque paraissait, en 1867, un recueil de poésies, les Flocons, dont la première était dédiée à Hugo. La légende veut que, désargenté, son auteur ait dû vendre la lettre autographe que le maître lui avait adressée. Le secrétaire de Vallès ne tarda pas à fonder son premier journal le Faubourg, interdit dès son troisième numéro pour offense envers l’empereur et l’impératrice. Condamné de ce chef à huit mois de prison et 2000 francs d’amende, le 11 mars 1870, il se réfugia en Belgique, en Hollande, puis à Londres. Après le 4 septembre, il s’empressa de revenir à Paris et fut incorporé dans la garde nationale mobile, avant d’être réformé, « épuisé par les excès d’une jeunesse orageuse », nous disent ses accusateurs, mais Vallès n’ignorait pas que « le rat de la phtisie » s’était logé en lui.
Une lettre de dénonciation

C’est de sa ville natale qu’était partie une lettre de dénonciation, et il fut arrêté, le 9 juillet 1871, à Belleville, au domicile d’une « ouvrière en abat-jour et ustensiles d’éclairage », qui le faisait passer pour son fils. Il fallut l’extraire de l’hôpital militaire de Versailles pour soumettre à des interrogatoires « un de ces bohêmes de la littérature qui, à peine sortis du collège, se font les apôtres des théories les plus malsaines et les plus subversives ». La pièce la plus « incendiaire » retenue à sa charge est un article de la Montagne du 21 avril, dans lequel il appelait de ses vœux le temps où « la charogne d’un évêque ne [pèserait] pas plus dans la balance de la justice que le cadavre d’un ouvrier » et exigeait de la Commune qu’elle tînt sa promesse de mettre à mort l’otage Darboy si Blanqui ne lui était pas rendu…
Par jugement rendu le 2 octobre, le 3e Conseil de guerre le condamna à la peine de mort « et aux frais envers l’État, comme coupable de provocation à un attentat ayant pour but d’exciter la guerre civile, de complicité d’assassinat sur la personne de Mgr Darboy, en provoquant au crime par des écrits rendus publics, de provocation au pillage en bande, de publication de fausses nouvelles, faite de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique, et d’offense envers le chef de Gouvernement par des écrits rendus publics. » Son avocat, Me Léon Bigot, avait vainement plaidé l’acte politique pour lequel la peine capitale était abolie depuis 1848 : « Maroteau n’implore, ne demande pas sa grâce, il ne veut que la justice ! » Après rejet du recours en révision, puis du pourvoi, la peine fut commuée le 10 janvier 1872, mais l’intervention de Hugo ne put lui éviter les « galères à perpétuité ». On rapporte son échange avec Émile Fortin, lorsque tous deux furent ferrés au bagne de Toulon :
— Eh bien ! mon vieux, qu’est-ce que tu dis de cela ?
— Je dis que cela n’est pas gai.
— C’est vrai, mais, au moins, ce n’est pas banal.
Au bagne en nouvelle-calédonie
Le transporter à l’île Nou, où il arriva le 24 octobre au terme d’une navigation de 145 jours, c’était l’envoyer à la mort. Dans l’infirmerie à bord de la Virginie, a témoigné Simon Mayer,
retentissait jour et nuit la toux déchirante de Maroteau, qui agonisait, phtisique, sur son matelas trempé d’eau de mer.
À sa mère, sollicitant un adoucissement dans l’application de la peine, Victor Lefranc, ministre de l’Intérieur en 1872, répondit : « Madame, je ne connais qu’un bagne ! » Du moins son fils échappa-t-il à la quatrième catégorie et à la double chaîne, qu’ont connues Henri Brissac, Alexis Trinquet ou Raoul Urbain. Avec Gaston Da Costa, Émile Fortin, Émile Giffault, il forma une espèce de « gamelle » à laquelle chacun apportait les ressources dont il pouvait disposer, pour éviter la promiscuité avec les condamnés de droit commun, l’« écume des scélérats ». Mais Maroteau dut multiplier les séjours à l’hôpital du pénitencier ; il s’y trouvait notamment en décembre 1872 et en mars 1874 : c’est l’adresse qu’il communique à son ami Bauër, déporté à la presqu’île Ducos.
Sa santé se dégrada fortement au début de l’année 1875. Informé par le médecin qu’il ne lui restait que quelques heures à vivre, il écrivit, le 16 mars à sa "mère aimée" :
Je meurs… et je t’envoie mon dernier adieu.
Tu n’aurais point cru, alors que tout petit tu me berçais dans mon berceau d’enfant, que je finirais ainsi à six mille lieues de toi, sur un grabat du bagne, le grabat qu’aurait eu Lacenaire, si on avait daigné, comme à moi, lui faire grâce de la vie.
Je meurs et je t’aime.
Je meurs et j’ai cette consolation de savoir que la liberté triomphe, et que ma muse, ma vieille muse en cheveux gris, me survit pour demander justice et vengeance.
Je t’embrasse dix millions de fois.
Il aurait dit à ses amis qui se pressaient autour de lui :
Ce n’est pas une grande affaire de mourir, mais j’eusse préféré le plateau de Satory [où il aurait été fusillé] à ce grabat infect.
Il légua sa pipe à son collègue journaliste Humbert, son carnet à Fortin, qui lui était le plus proche, et ses dettes… à la République. Il avait annoncé, pendant la Commune : « Biffons Dieu », et, mourant, invitait l’aumônier du bagne, le père mariste Montrouzier, à se retirer :
Monsieur, vous me blesseriez profondément en vous approchant de moi. » Louise Michel, à qui elle fut rapportée, romance ainsi sa fin : « On attendait sa mort dès le 16 mars, l’agonie étant commencée. Tout à coup, il se soulève et, s’adressant au médecin : - La science, dit-il, ne peut donc pas me faire vivre jusqu’à mon anniversaire, le 18 mars. - Vous vivrez, dit le médecin qui ne put cacher une larme.

Maroteau mourut le 18 mars, soit quatre ans après le début de l’insurrection parisienne, mais, étant né le 28 juillet 1849, il n’avait pas encore 26 ans... Il fut enterré dans un coin du cimetière des forçats « sur le haut d’une côte où la vue est admirable et je pensais à lui qui aimait tant les belles choses », précise Giffault qui nous a laissé un croquis de sa tombe.
Le cœur d’une mère
Informée par leurs soins de la mort de son fils, Cécilia Maroteau adressa la lettre suivante de Paris, le 8 juillet 1875, « à Alphonse [Humbert], Gaston [Da Costa], mes deux Émile [Fortin et Giffault] :
Mes chers enfants,
Je ne puis vous dire l’émotion touchante que j’ai ressentie en recevant de vous ces lignes si tendres, inspirées par votre amitié pour mon bien-aimé ; j’ai cru un instant qu’il revivait en vous. Oui ! Vous êtes mes enfants, le cœur des mères est assez vaste pour contenir toutes ces tendresses. Vous devez me porter les baisers que mon fils vous a donnés pour moi.
Je veux vivre pour que vous me les rendiez ; je veux obéir à sa chère mémoire ; je vous attends pour me fermer les yeux. Peut-être votre retour devancera-t-il nos espérances. Courage !
Vos parents sont des amis pour moi ; leur douce amitié me fait oublier mon isolement et, lorsque je suis triste, je vais chez eux retremper mon courage, savoir de vos nouvelles à tous les quatre, lire les mots affectueux que vous mettez pour moi dans vos lettres. Je sens qu’il me reste des enfants à aimer ; je prends ma part dans le bonheur de vos familles devenues la mienne.
Au revoir, mes chers enfants ; votre vieille mère adoptive vous embrasse de tout cœur.
Tous quatre revinrent de leur exil néo-calédonien, et Vallès de Londres où il avait trouvé refuge. Dans le Citoyen de Paris, du 22 mars 1881, lui, qui avait ouvert à Maroteau « les portes du journalisme, et peut-être du bagne, - peut-être du cimetière », annonça l’organisation d’une matinée au bénéfice de sa mère qui était veuve : elle se tint le 4 avril au théâtre des Nations ; c’était désormais elle qu’il fallait « adopter comme une enfant, dans sa misère et son abandon », cette « orpheline de la Révolution, cette femme à cheveux blancs », dont les obsèques au cimetière de Clichy, le 1er août 1885, furent suivies par un millier de survivants de la Commune.
YANNICK LAGEAT